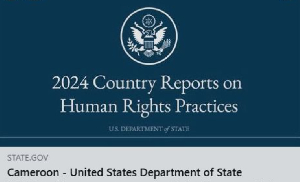 Rapport des Etats Unis sur les Droits de l'Homme au Cameroun
Rapport des Etats Unis sur les Droits de l'Homme au Cameroun
Le traditionnel rapport des Etats Unis d'Amérique sur la situation des Droits de l'Homme dans tous les pays du monde, a été rendu publique par l'US Department of State. Les récentes dérives des autorités camerounaises n'ont pas échappé à l'Administration Trump. Dans ce rapport, les Etats Unis notent des exécutions extrajudiciaires, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les violations graves de la liberté de presse etc.
Les rapports annuels par pays sur les pratiques en matière de droits de l'homme – le Rapport sur les droits de l'homme – font le point sur la situation des droits de l'homme et des droits des travailleurs internationalement reconnus. Le Département d'État américain soumet au Congrès américain des rapports sur tous les pays bénéficiaires d'une aide et sur tous les États membres des Nations Unies, conformément à la loi sur l'aide étrangère de 1961 et à la loi sur le commerce de 1974.
La rédaction de CamerounWeb a retrouvé le rapport du département d'Etat des Etats Unis et vous le propose en intégralité:
"RÉSUMÉ EXÉCUTIF
La situation des droits humains au Cameroun a connu des évolutions positives et négatives au cours de l'année. Le nombre de victimes civiles a diminué grâce au respect accru des droits humains par les forces de sécurité gouvernementales dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parallèlement, des rapports font état de restrictions accrues imposées par le gouvernement à la liberté d'expression et à la liberté des médias.
Parmi les problèmes importants en matière de droits de l’homme, on peut citer des rapports crédibles faisant état de : exécutions arbitraires ou illégales ; torture ou peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; arrestations ou détentions arbitraires ; répression transnationale contre des individus dans un autre pays ; abus graves dans un conflit ; recrutement ou utilisation illégaux d’enfants dans un conflit armé par le gouvernement et des groupes non étatiques ; restrictions graves à la liberté d’expression et à la liberté des médias, y compris la violence ou les menaces de violence contre des journalistes, les arrestations ou poursuites injustifiées de journalistes, la censure et l’application ou la menace de lois pénales ou civiles afin de limiter l’expression ; et restrictions systématiques à la liberté d’association des travailleurs.
Le gouvernement a pris des mesures crédibles pour identifier et punir les fonctionnaires qui ont commis des violations des droits de l’homme.
Les séparatistes armés, Boko Haram, l’État islamique d’Irak et de Syrie-Afrique de l’Ouest, des gangs criminels et d’autres acteurs non étatiques ont commis des violations des droits de l’homme, dont certaines ont fait l’objet d’une enquête du gouvernement.
Section 1.
Vie
a. Exécutions extrajudiciaires
Plusieurs rapports ont fait état d’exécutions arbitraires et illégales commises par le gouvernement ou ses agents au cours de l’année.
Le 12 mai, le sergent-chef Sanda, officier du Bataillon d'intervention rapide (BIR), a tiré sans discernement sur des civils dans une boîte de nuit de Limbé, dans la région du Sud-Ouest, selon l'organisation non gouvernementale (ONG) Centre Mandela International, tuant une personne et en blessant plusieurs autres. La police a appréhendé Sanda et l'a placé en garde à vue dans une brigade de gendarmerie. Le Centre Mandela International a rapporté que des témoins ont affirmé que Sanda avait agi en représailles au meurtre de son collègue par des séparatistes.
Le 19 juin, deux civils ont péri dans une explosion à Melim, Kumbo, dans la région du Nord-Ouest, selon les médias. Des soldats du BIR les auraient contraints à désactiver un engin explosif improvisé (EEI) à mains nues. Les soldats avaient auparavant bloqué la circulation après avoir détecté l'EEI, apparemment placé sur la route par des séparatistes, et auraient contraint les deux passants à participer à sa désactivation. Lorsque les deux hommes sont entrés en contact avec l'engin, celui-ci a explosé et les a tués sur le coup. Des témoins ont rapporté que les soldats avaient renvoyé tout le monde et abandonné les corps sur la route. Le gouvernement a nié que l'incident se soit produit tel que rapporté et que le BIR ait contraint des civils à désactiver des EEI.
Des journalistes et des ONG ont signalé des exécutions arbitraires et illégales de civils par des groupes armés non étatiques dans le cadre de conflits qui se sont poursuivis dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord.
b. Coercition dans le contrôle de la population
Aucun cas d’avortement forcé ou de stérilisation involontaire de la part des autorités gouvernementales n’a été signalé.
c. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité et preuves d'actes pouvant constituer un génocide
Des rapports ont fait état de nombreux meurtres délibérés de civils par les forces gouvernementales et les combattants séparatistes. Bien que des observateurs indépendants aient accusé les forces gouvernementales d'avoir tué des civils non armés, les autorités ont affirmé que les personnes tuées par les forces gouvernementales dans les zones de conflit étaient en réalité des séparatistes. Les séparatistes ont également attaqué et tué des fonctionnaires et des civils accusés d'avoir aidé les forces gouvernementales ou qui n'avaient pas respecté les mesures de confinement imposées par les séparatistes.
Le Centre Mandela International et les médias ont rapporté que le 11 avril, les forces de sécurité, à la recherche de séparatistes dans les villages de Banka/Bamfem, dans la division de Bui, région du Nord-Ouest, ont tué six civils non armés qu'elles accusaient de collaborer avec les séparatistes. Selon les médias, les soldats de Bamfem vengeaient la mort de leurs collègues pris dans une embuscade tendue par le groupe armé non étatique des Guerriers de Bui.
Selon les médias, Boko Haram et l'EI-AO ont mené des attaques dans la région de l'Extrême-Nord, tuant de nombreux civils. Dans son rapport de situation de mai, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a indiqué que les terroristes avaient tué 43 civils et enlevé huit autres dans les départements du Mayo Sava, du Mayo Tsanaga et du Logone-et-Chari.
Le 11 février, l'explosion d'un engin explosif improvisé (EEI) à Nkambe, ville de la région Nord-Ouest, a tué une jeune fille de 15 ans et blessé plus de 70 personnes. Lucas Ayaba Cho, chef du Conseil de gouvernement séparatiste d'Ambazonie (CGO) et de sa branche armée, les Forces de défense d'Ambazonie (ADF), basé en Norvège, a revendiqué l'attaque. Il a déclaré que le groupe visait un député et avait imposé un confinement aux communautés pendant la célébration annuelle de la Journée de la jeunesse. Les autorités ont annoncé l'arrestation de trois personnes en lien avec cet attentat. Le gouvernement a coopéré avec la Norvège en arrêtant le chef séparatiste Cho en septembre et en l'accusant d'« incitation à des crimes contre l'humanité ».
Section 2.
Liberté
a. Liberté de la presse
La loi garantissait la liberté d'expression, notamment pour les membres de la presse et des autres médias, mais le gouvernement a souvent restreint ce droit, explicitement ou implicitement. Les autorités gouvernementales ont publié des déclarations et interprété largement les lois relatives à la lutte contre le terrorisme, à l'ordre public, à la désinformation et aux discours de haine afin de sanctionner la dissidence et d'encourager l'autocensure de propos pourtant protégés.
Des responsables gouvernementaux auraient refusé à des individus ou à des organisations la possibilité de critiquer ou d'exprimer des opinions contraires à la politique gouvernementale. Ils auraient également refusé aux citoyens la possibilité de discuter de certaines questions d'intérêt général, notamment l'expression d'opinions concernant la transition politique. Des représailles auraient été exercées contre des personnes ayant critiqué le gouvernement, en privé ou en public.
Selon Human Rights Watch, le 21 juin, des gendarmes de Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa, ont arrêté Aboubacar Siddiki, dit Babadjo, membre du parti Union nationale pour la démocratie et le progrès, pour trouble à l'ordre public, manifestation et discours de haine. L'arrestation de Siddiki a eu lieu peu après sa libération de prison suite à une précédente arrestation le 8 mars, pour laquelle il avait purgé une peine de trois mois de prison pour avoir insulté le gouverneur régional de l'Adamawa sur un groupe WhatsApp. Son avocat a déclaré que l'arrestation du 21 juin était fondée sur des allégations des services de renseignement selon lesquelles les partisans de Siddiki prévoyaient de manifester pour célébrer sa libération. Le 24 juin, son avocat a déposé une requête en habeas corpus devant la Haute Cour de Ngaoundéré, mais Siddiki était toujours en détention à la fin de l'année.
Le blasphème était un délit pénal. Aucun cas connu n'a été poursuivi en vertu de la loi sur le blasphème au cours de l'année.
Agressions physiques, emprisonnement et pressions
La police, la gendarmerie et d'autres agents du gouvernement auraient arrêté, détenu, agressé physiquement et intimidé des journalistes. Des journalistes et des éditeurs ont signalé des cas de harcèlement téléphonique et d'intimidation. Les journalistes ont pratiqué l'autocensure, s'abstenant d'aborder des sujets pouvant être perçus comme critiques envers le gouvernement en raison du harcèlement et de l'intimidation de celui-ci.
En août, le commentateur politique Aristide Mono, critique régulier du gouvernement, a affirmé que des agents de sécurité et de renseignement à Douala avaient tenté à deux reprises de l'arrêter. Mono a indiqué avoir reçu une convocation administrative des autorités de Douala et avoir hésité à quitter sa résidence à Yaoundé par crainte d'être enlevé ou tué, comme cela avait été le cas pour d'autres journalistes par le passé. Mono a accusé le gouvernement de le harceler et de l'intimider parce qu'il avait attiré l'attention du public sur l'absence de bonne gouvernance et de justice sociale et qu'il avait critiqué le gouvernement. Mono a signalé les incidents aux agences de sécurité gouvernementales à Yaoundé et a repris ses déplacements à Douala, mais a fait état d'un harcèlement continu de la part des autorités locales.
Le 20 août, trois individus non identifiés ont agressé physiquement Emmanuel Ekouli, correspondant de Reporters sans frontières et directeur de publication du journal La Voix du Centre à Etoudi (Yaoundé), alors qu'il rentrait du travail. Selon Ekouli, les assaillants l'ont fait descendre de sa moto et l'ont roué de coups de poing et de pied jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ekouli a subi de multiples blessures. Il avait déjà été pris pour cible le 9 juillet, lorsque trois individus à moto l'avaient frappé à coups de matraque et lui avaient volé ses papiers d'identité et ses documents professionnels à Ngoussou (Yaoundé). Les médias ont interprété ces attaques comme une tentative d'intimidation à l'encontre d'Ekouli, dont les reportages étaient jugés trop critiques par certaines personnalités politiques.
Censure par les gouvernements, les forces militaires, les services de renseignement ou de police, les groupes criminels ou les groupes armés extrémistes ou rebelles
La loi imposait aux rédacteurs en chef de soumettre deux exemplaires signés de leurs journaux dans les deux heures suivant leur publication, mais le gouvernement ne l'a pas appliquée et les éditeurs ne se sont pas conformés à cette exigence. Le ministère de la Communication exerçait une autorité de contrôle sur les médias et les organisations de médias audiovisuels accréditées ; le gouvernement central accréditait également la presse écrite. Des journalistes et des médias ont signalé avoir pratiqué l'autocensure, en particulier si le Conseil national de la communication (NCC), l'organisme de régulation des médias, nominalement indépendant, les avait déjà suspendus. Le NCC a suspendu des journalistes et des éditeurs à la suite de plaintes publiques et pour des contenus jugés contraires à la politique gouvernementale. Le NCC a invoqué le « professionnalisme » et la « responsabilité sociale » pour sanctionner la liberté d'expression. En février, juin et août, le NCC a sanctionné des professionnels des médias de 11 médias, avec des sanctions allant de l'interdiction totale du média à trois mois de suspension de l'exercice du journalisme. Parmi les sanctions les plus importantes figurait la suspension d'un mois d'une émission d'Equinoxe Television et de son présentateur, Duval Fangwa Gnakwa, pour avoir diffusé des « déclarations infondées et des insultes » à l'encontre du ministre de l'Administration territoriale. Le 11 août, trois jours après la suspension, Equinoxe Television a diffusé une émission politique similaire, ce qui a conduit le NCC à accuser Equinoxe de tenter de contourner la sanction et à interdire immédiatement l'émission de remplacement pour la durée de la suspension initiale d'un mois. Le 4 septembre, le président du NCC a annoncé qu'il fermerait définitivement tout média ne respectant pas ses règles.
Plusieurs cas de groupes séparatistes armés dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ont été signalés, entravant la liberté d'expression, notamment celle de la presse. De plus, les préoccupations pour la sécurité personnelle et les restrictions de mouvement imposées par les séparatistes armés ont encore davantage limité la liberté d'expression des journalistes.
Efforts pour préserver l'indépendance des médias
En août et septembre, le président du CNC a mené une tournée de sensibilisation auprès des médias de Yaoundé et de Douala. Cette tournée visait à sensibiliser les rédacteurs en chef, les modérateurs et les propriétaires de médias à la responsabilité sociale des journalistes et aux meilleures pratiques en matière de programmes interactifs, de talk-shows en direct et de débats. Elle a permis aux professionnels des médias de partager leurs expériences et de faire part de leurs préoccupations au CNC.
Le gouvernement a accordé des subventions aux médias privés répondant à certains critères, dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir des médias durables, favorisant notamment la démocratie. Certaines ONG ont qualifié cette aide de totalement insignifiante.
b. Droits des travailleurs
Liberté d'association et de négociation collective
La loi garantissait aux travailleurs le droit de former et d'adhérer à des syndicats indépendants, de négocier collectivement et de faire grève, mais avec d'importantes restrictions. Ces droits ne s'appliquaient pas à certains groupes de travailleurs, notamment le personnel de la défense et de la sécurité nationale, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et le personnel judiciaire et juridique. La loi interdisait également la discrimination antisyndicale et exigeait la réintégration des travailleurs licenciés pour activité syndicale. Des limitations légales et d'autres pratiques restreignaient considérablement ces droits.
Selon les dirigeants syndicaux, la loi interdisait la création d'un syndicat regroupant des travailleurs des secteurs public et privé, ou regroupant des secteurs différents, même étroitement liés. La loi exigeait que les syndicats s'enregistrent auprès du gouvernement, comptent au moins 20 membres et soient officialisés en soumettant une demande comprenant les statuts et les règlements au greffier des syndicats et des associations patronales, qui délivrait un certificat d'enregistrement au syndicat dans un délai d'un mois. En l'absence de réponse du greffier dans ce délai, le syndicat était considéré comme enregistré. Les membres fondateurs devaient également avoir un casier judiciaire vierge. Les personnes qui formaient un syndicat et menaient des activités syndicales sans être enregistrées étaient passibles d'amendes. Il était interdit aux syndicats d'exercer toute activité non liée à l'étude, à la défense, au développement et à la protection des intérêts des travailleurs.
Plus de 100 syndicats et 12 confédérations syndicales étaient en activité, dont une confédération du secteur public. Les syndicats ou associations de fonctionnaires n'étaient pas autorisés à adhérer à une organisation professionnelle ou syndicale étrangère sans l'autorisation préalable du ministre de l'Administration territoriale, chargé du « contrôle des libertés publiques ».
La Constitution et la loi prévoyaient la négociation collective entre travailleurs et direction, ainsi qu'entre fédérations syndicales et associations patronales dans chaque secteur économique. La loi n'obligeait pas les employeurs à négocier. Elle ne s'appliquait pas aux secteurs agricole et informel, qui regroupaient la majeure partie de la main-d'œuvre.
Les grèves ou lock-out légaux ne pouvaient être déclenchés qu'après épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage. Les travailleurs qui ne respectaient pas les procédures de grève s'exposaient à un licenciement ou à des amendes. Les zones franches industrielles étaient soumises au droit du travail, mais plusieurs exceptions limitaient les droits des travailleurs. Dans les zones franches industrielles, les employeurs avaient le droit de fixer les salaires en fonction de la productivité, ce qui leur permettait de verser des salaires inférieurs au salaire minimum, de négocier des contrats de travail en dehors des réglementations du droit du travail et de délivrer des permis de travail aux travailleurs étrangers sans la procédure de contrôle gouvernemental, généralement longue.
Le gouvernement et les employeurs n'appliquaient souvent pas efficacement les lois applicables en matière de liberté d'association et de droit de négociation collective. Les sanctions en cas de violation étaient rarement appliquées et étaient moins lourdes que celles appliquées pour des violations analogues, telles que les violations des droits civils. Les procédures administratives et judiciaires étaient peu fréquentes et sujettes à de longs délais et recours.
De nombreux employeurs auraient eu recours à des sous-traitants pour éviter d'embaucher des travailleurs bénéficiant du droit à la négociation collective. De grandes entreprises, y compris des entreprises parapubliques et publiques, se sont livrées à cette pratique, selon des travailleurs d'Eneo, de la société d'approvisionnement en eau Cameroon Water Utilities Corporation, du cimentier Cimencam, de Guinness, de la fonderie d'aluminium, de la Cameroon Oil Transportation Company, d'Ecobank et de bien d'autres. La sous-traitance aurait concerné toutes les catégories de personnel, des plus bas échelons aux plus hauts échelons. Par conséquent, les travailleurs à expertise et expérience égales ne bénéficiaient pas toujours des mêmes protections lorsqu'ils travaillaient pour la même entreprise, et le personnel sous-traité n'avait généralement pas de base légale pour déposer plainte.
Plusieurs grèves ont été annoncées au cours de l'année. Certaines ont été annulées après des négociations fructueuses ; d'autres se sont déroulées pacifiquement, et d'autres encore ont fait face à une certaine répression. En août, les dockers du port de Douala ont organisé deux manifestations, bloquant l'accès au port et empêchant toute activité. Les travailleurs ont dénoncé de mauvaises conditions de travail et exigé des augmentations de salaire ainsi qu'une meilleure couverture maladie et assurance pour eux-mêmes et leurs familles. À l'issue des négociations, le 22 août, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a présidé à la signature d'une convention collective entre les syndicats de dockers et les employeurs, prévoyant des augmentations de salaire allant jusqu'à 48 %, entre autres avantages. Une commission paritaire des relations professionnelles, dirigée par le gouvernement, a arbitré le conflit.
Avec le développement des syndicats dans le secteur informel, le gouvernement a négocié des conventions collectives dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'assainissement, ainsi qu'avec les employés des collectivités locales, qui se trouvaient dans une zone d'ombre juridique concernant leurs droits. Le gouvernement a également accepté d'augmenter les tarifs des taxis à la demande des chauffeurs de taxi qui s'étaient organisés après la hausse du prix du carburant en février.
Travail forcé ou obligatoire
Consultez le rapport annuel du Département d’État sur la traite des personnes à l’adresse .
Conditions de travail acceptables
Lois sur les salaires et les horaires de travail
Le 21 février, le gouvernement a augmenté les salaires des fonctionnaires de 5 pour cent, suite à une augmentation du prix du carburant le 3 février. Le gouvernement n'a pas augmenté le salaire minimum garanti dans le secteur privé, malgré les appels à une augmentation des syndicats.
Dans tous les secteurs, le salaire minimum était supérieur au seuil de pauvreté fixé par la Banque mondiale. La prime pour les heures supplémentaires variait de 120 à 150 % du taux horaire, selon le nombre d'heures supplémentaires effectuées et s'il s'agissait d'heures supplémentaires de fin de semaine ou de nuit. Malgré la loi sur le salaire minimum, les employeurs négociaient souvent des salaires inférieurs avec les travailleurs, en partie à cause d'un taux de sous-emploi extrêmement élevé dans le pays. Les salaires inférieurs au salaire minimum restaient fréquents dans le secteur des travaux publics, où de nombreux postes requéraient une main-d'œuvre non qualifiée, ainsi que dans le travail domestique, où les femmes réfugiées étaient particulièrement vulnérables aux pratiques de travail déloyales.
La loi a instauré une semaine de travail standard de 40 heures dans les entreprises publiques et privées non agricoles et un total de 2 400 heures par an, avec une limite maximale de 48 heures par semaine dans les activités agricoles et connexes. Des exceptions ont été prévues pour les agents de sécurité et les pompiers (56 heures par semaine), le personnel du secteur des services (45 heures par semaine) et le personnel de maison et de restauration (54 heures par semaine). La loi imposait au moins 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Sécurité et santé au travail
Le gouvernement a établi des normes de sécurité et de santé au travail (SST) généralement appropriées sur le lieu de travail. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a établi une liste de maladies professionnelles en consultation avec la Commission nationale d'hygiène et de sécurité industrielles. Les inspecteurs du ministère et les médecins du travail étaient chargés de surveiller le respect des normes de SST. Le gouvernement n'a pas identifié proactivement les conditions dangereuses et a rarement lancé des inspections du travail susceptibles de révéler des conditions de travail dangereuses. Les travailleurs étaient parfois incapables de se soustraire à des situations mettant en danger leur santé ou leur sécurité sans compromettre leur emploi, et certains syndicats se sont plaints de la fréquence des « licenciements abusifs ».
Application des règles relatives aux salaires, aux horaires et à la SST
Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale était chargé de faire respecter les lois sur le salaire minimum, les heures supplémentaires et la SST, mais il ne s'en acquittait pas efficacement. Les inspecteurs du travail étaient autorisés à effectuer des inspections inopinées et tentaient de le faire lorsqu'ils disposaient d'informations désobligeantes concernant une entreprise. Ces visites inopinées étaient parfois contrecarrées par le manque de volonté politique dans certains secteurs, comme l'exploitation minière, le manque de coopération de l'entreprise ciblée et, dans certains cas, les menaces physiques proférées par les employés. Les sanctions pour les infractions à la loi étaient moins lourdes que celles pour des délits comparables, tels que la fraude ou la négligence. Les sanctions étaient rarement appliquées aux contrevenants. Des rapports crédibles suggéraient que certaines entreprises ne fournissaient pas de services de santé à leurs employés, contrairement à la loi, mais rarement appliquée. Le nombre total d'inspecteurs du travail était insuffisant et le ministère manquait de ressources pour mettre en place un programme d'inspection complet. Au cours de l'année, la National Mining Corporation, une entreprise publique, a mené une campagne de sensibilisation du public visant à réduire le travail des enfants dans les mines.
L'Organisation internationale du travail a indiqué que les travailleurs informels représentaient 90 % de la population active du pays. Le gouvernement n'appliquait pas les lois et réglementations du travail dans le secteur informel.
c. Disparition et enlèvement
Disparition
Aucune disparition forcée n’a été signalée par ou pour le compte des autorités gouvernementales au cours de l’année.
Détention prolongée sans inculpation
La Constitution et la loi interdisaient les arrestations et détentions arbitraires et prévoyaient le droit de toute personne de contester la légalité de son arrestation ou de sa détention devant un tribunal et d'obtenir réparation pour les préjudices graves résultant d'une détention illégale. Le gouvernement n'a pas toujours respecté ces dispositions.
La loi prévoyait qu'un suspect de terrorisme pouvait être maintenu indéfiniment en détention provisoire avec l'autorisation du procureur. Les autorités administratives, telles que les gouverneurs et les fonctionnaires civils du gouvernement en poste dans les territoires, pouvaient également autoriser la détention de personnes sans inculpation pour des périodes renouvelables de 15 jours. Il semblerait que les policiers et les gendarmes dépassent souvent les délais de détention prescrits.
La loi interdisait la détention au secret, mais de tels cas se seraient produits, notamment en lien avec des personnes accusées d'appartenir à des séparatistes ou de les soutenir dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il semblerait que les juges ne libèrent pas souvent les accusés sous caution.
Des policiers, des gendarmes, des militaires et d'autres autorités gouvernementales auraient arrêté et détenu des personnes arbitrairement sans mandat, les détenant souvent pendant de longues périodes sans inculpation ni procès, et parfois au secret. Les motifs de ces arrestations et détentions n'étaient souvent révélés que des semaines, voire des mois plus tard.
Le 8 septembre, les forces de sécurité auraient arrêté sans discernement des centaines de personnes dans les quartiers de Nitop, Metta Quarters, Noble Man et Mancho à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, et les auraient détenues au commissariat central de Bamenda. Les autorités ont accusé les détenus d'être des séparatistes ou d'être des proches de séparatistes qu'ils refusaient de dénoncer. Les victimes ont déclaré aux médias qu'elles avaient dû verser chacune 5 000 francs CFA (8 dollars) pour obtenir leur libération, celles qui n'avaient pas pu réunir cette somme étant restées en détention. Les agents de sécurité auraient également confisqué de l'argent et des biens, et extorqué des détenus pour qu'ils leur rendent leurs motos.
La loi prévoyait une détention provisoire maximale de 18 mois, mais de nombreux détenus attendaient des années avant de comparaître devant le tribunal. Bien que la loi prévoyait la libération sous caution des accusés pour tous les crimes sauf les plus graves, le Barreau estimait que 75 % des personnes en détention provisoire, soit environ 14 300 personnes, étaient accusées de délits mineurs, les mineurs étant particulièrement touchés. Des avocats et des ONG de plusieurs régions du pays ont signalé que les longues détentions provisoires étaient principalement dues à une corruption endémique, les juges et les agents de sécurité brandissant la menace d'une garde à vue prolongée ou d'une détention pénitentiaire pour exiger des pots-de-vin que de nombreux détenus ne pouvaient pas payer. Parmi les autres facteurs contribuant à la longueur des détentions provisoires, on peut citer le manque de personnel judiciaire, la mauvaise gestion des dossiers, l'impossibilité de payer les frais de justice, le refus abusif de libération sous caution et la politisation de certaines procédures judiciaires nécessitant des directives du gouvernement central.
En septembre, le journaliste indépendant Kingsley Fumunyuy Njoka, en détention provisoire depuis son arrestation en 2020, a été condamné à dix ans de prison. Initialement arrêté pour des articles sur la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il a finalement été inculpé de crimes de sécession et de « complicité avec des bandes armées ».
d. Violations de la liberté religieuse
Consultez le rapport annuel du Département d’État sur la liberté religieuse internationale à l’ adresse https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ .
e. Traite des êtres humains
Consultez le rapport annuel du Département d’État sur la traite des personnes à l’ adresse https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ .
Section 3.
Sécurité de la personne
a. Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
La Constitution et la loi interdisaient de telles pratiques, mais des rapports anecdotiques et des témoignages de survivants suggèrent que des responsables gouvernementaux y ont eu recours. Des ONG de défense des droits humains ont signalé que les forces de sécurité ciblaient souvent les citoyens anglophones en les arrêtant et en les détenant sans mandat et en les soumettant à des violences afin de leur extorquer des informations ou des aveux. Souvent, ces détenus étaient libérés sans inculpation.
En avril, des soldats du 21e Bataillon d'infanterie motorisée (BIM) auraient torturé un individu dans leur base de Buea, dans la région du Sud-Ouest, après que d'autres personnes l'eurent accusé d'être impliqué dans un vol à main armée, selon l'avocat de la victime et d'autres sources. Selon la victime, les soldats du BIM ont perquisitionné son domicile et vérifié son téléphone portable, mais n'ont trouvé aucune preuve de son implication. La victime a déclaré que les soldats lui avaient attaché les mains et les pieds, l'avaient aspergé d'eau chaude, l'avaient soumis à la simulation de noyade et l'avaient battu à coups de machette, lui infligeant de graves blessures aux mains, aux bras et aux jambes. Après deux mois de détention, les soldats l'ont libéré. Ils l'ont contraint à avouer par vidéo qu'il était séparatiste et ont tenté de l'empêcher de signaler ce qu'ils lui avaient fait, a déclaré la victime. Selon son avocat, la gendarmerie a ouvert une enquête et recueilli les déclarations des responsables du BIM, qui affirmaient travailler sous les ordres de hauts fonctionnaires. L'avocat a déclaré qu'au 4 septembre, les hauts fonctionnaires n'avaient pas répondu aux demandes de témoignage des enquêteurs. L'enquête était toujours en cours à la fin de l'année.
Des journalistes et des ONG ont signalé que des groupes armés non étatiques se livraient à des violences physiques contre des civils dans le cadre de conflits qui se poursuivaient dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord.
Le 6 janvier, les médias ont rapporté et diffusé des images de la torture présumée de Ngang Musongong, un employé du conseil municipal de Moyoka, dans la région du Sud-Ouest, par des séparatistes se présentant comme membres des ADF. Ces images montraient Musongong ligoté et couvert de sang, tandis que ses ravisseurs l'accusaient d'être un traître à la cause séparatiste et un collaborateur du gouvernement.
Le gouvernement a pris des mesures pour identifier, poursuivre et punir certains fonctionnaires responsables d'abus, mais l'impunité demeurait un grave problème, notamment au sein de la Direction de la sécurité militaire (SEMIL) et de la gendarmerie. En octobre, suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de 2019 montrant quatre individus en civil, membres présumés de la SEMIL, en train de frapper à coups de machette le chanteur et militant Simon Longkana Agno (surnommé « Longue Longue »), le ministère de la Défense a publié un communiqué condamnant l'incident et annonçant l'ouverture d'une enquête. Cependant, cette action n'a pas été systématique et les résultats des enquêtes et autres procédures ont rarement été rendus publics.
b. Protection des enfants
travail des enfants
Consultez les conclusions du ministère du Travail sur les pires formes de travail des enfants à l’ adresse https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings .
Enfants soldats
Le secrétaire d'État a déterminé que le Cameroun disposait de forces armées gouvernementales, de police ou d'autres forces de sécurité qui ont recruté ou utilisé des enfants soldats dans des rôles de soutien au cours de la période d'avril 2023 à mars 2024. Voir le rapport annuel du Département d'État sur la traite des personnes à l'adresse .
Le gouvernement a organisé, avec la participation de l'ONU, un atelier national visant à formaliser un protocole pour le transfert et la prise en charge des enfants affiliés à des groupes armés. Il a également adopté une feuille de route pour la mise en œuvre de services éducatifs, mentaux et psychosociaux pour les enfants et pour offrir des possibilités de formation professionnelle. Le président de la Commission camerounaise des droits de l'homme a indiqué avoir fait part de ses préoccupations concernant les enfants servant dans des rôles de soutien militaire aux principaux acteurs du ministère de la Défense, qui se sont engagés à enquêter et à traiter la question.
Les médias, les organisations de la société civile et d'autres acteurs ont signalé que Boko Haram recrutait et utilisait des enfants soldats, notamment des filles, lors d'attaques contre des cibles civiles et militaires. Certains groupes communautaires, connus sous le nom de comités de vigilance, auraient utilisé et recruté des enfants dans des opérations armées contre Boko Haram et d'autres groupes armés non étatiques. Selon des observateurs, les séparatistes des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest ont recruté et utilisé des enfants soldats au combat et pour recueillir des renseignements.
Mariage d'enfants
L'âge minimum légal du mariage était de 18 ans, mais la loi n'était pas appliquée efficacement. Les données de l'UNICEF sur le mariage des enfants en 2018 ont révélé que 31 % des femmes âgées de 20 à 24 ans étaient mariées avant l'âge de 18 ans et 11 % avant l'âge de 15 ans. Les mariages précoces et forcés, ainsi que les « mariages temporaires » abusifs – dans lesquels les couples acceptaient de se marier pour une durée déterminée et qui étaient utilisés pour masquer la prostitution des enfants et le travail forcé – étaient plus fréquents dans la partie nord du pays et dans certaines parties de la région de l'Ouest, en particulier dans la division du Noun.
c. Protection des réfugiés
Le gouvernement a généralement coopéré avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organisations humanitaires pour fournir protection et assistance aux réfugiés, aux réfugiés de retour ou aux demandeurs d’asile, ainsi qu’à d’autres personnes concernées.
Fourniture du premier asile
La loi prévoyait l'octroi de l'asile ou du statut de réfugié, et le gouvernement disposait d'un système de protection des réfugiés, mais sa mise en œuvre était défaillante. Le HCR fournissait des documents et une assistance aux réfugiés, bien que les autorités locales ne reconnaissent pas toujours ces documents comme officiels, ce qui empêchait les réfugiés de voyager et d'exercer une activité professionnelle.
d. Actes d'antisémitisme et d'incitation à l'antisémitisme
La population juive était très petite et aucun incident antisémite n’a été signalé.
e. Cas de répression transnationale
Des rapports crédibles ont indiqué que le gouvernement aurait exercé des représailles contre des individus se trouvant en dehors de ses frontières souveraines.
Meurtre extraterritorial, enlèvement, violence ou menaces de violence
Le 19 juillet, les forces de sécurité gabonaises ont arrêté le ressortissant camerounais Steve Akam, alias Ramon Cotta, critique du gouvernement camerounais et publiant fréquemment sur les réseaux sociaux. Les avocats de Cotta ont annoncé que, bien qu'ils pensaient que Cotta avait été transféré aux autorités camerounaises, ils n'avaient reçu aucune communication officielle à ce sujet et ignoraient où il se trouvait depuis plus de quatre semaines.
Le 20 août, Cotta a été traduit devant le tribunal militaire de Yaoundé, selon ses avocats. Cotta a déclaré à ses avocats avoir été interrogé à plusieurs reprises par des représentants du gouvernement et avoir été torturé à une occasion. Cotta a déclaré que des agents du gouvernement l'avaient battu et exposé à la lumière vive d'un projecteur, lui causant des lésions oculaires. L'avocat de Cotta a déclaré qu'il était accusé d'actes terroristes, de financement du terrorisme, d'insurrection, de trafic d'armes et d'outrage au chef de l'État et aux membres du gouvernement.
En octobre, il a été placé en détention provisoire pour une durée renouvelable de six mois en attendant son procès. L'avocat a déposé un recours en habeas corpus pour demander la libération de Cotta. Cotta était toujours en détention à la fin de l'année.